La fin du travail n’est pas la fin de tout
Hannah Arendt, l'automatisation et le vide politique de l'ère post-travail
IA
Sylvain Morizet
6/6/20255 min read
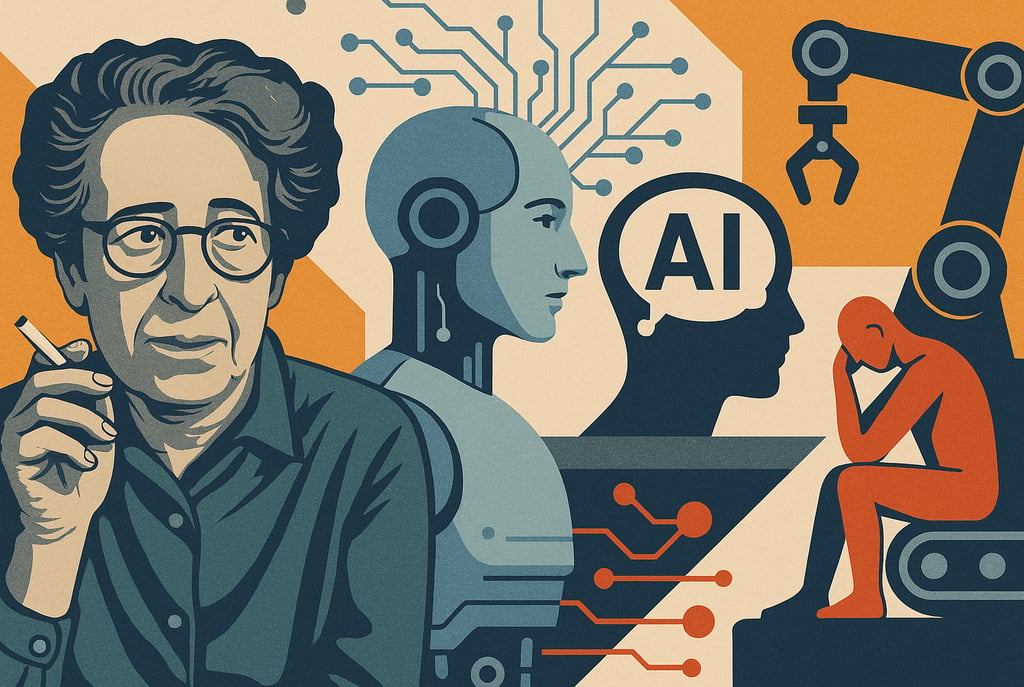
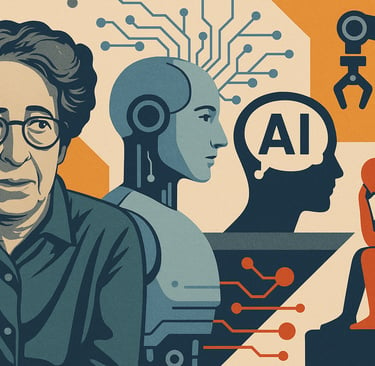
On a longtemps cru que le travail faisait l’homme. Mais que reste-t-il de l’homme quand le travail disparaît ? Loin des discours technophiles qui voient dans l'automatisation une libération du temps humain, Hannah Arendt pressentait dès les années 1950 un basculement autrement plus radical. Ce n’est pas le travail en tant que tel qui est en train de s’effacer : c’est le dernier lien tangible de l’homme à une société qui lui avait déjà retiré le politique, la création, et la parole.
Et aujourd’hui, l’intelligence artificielle accélère cette bascule. Elle ne se contente plus de soulager l’homme des tâches physiques : elle prend sa place dans les fonctions cognitives, analytiques, créatives, relationnelles. Ce n’est pas un simple outil : c’est un acteur à part entière d’un nouvel ordre productif, fondé sur des entités non humaines, propriétaires de leur efficacité. La Silicon Valley promettait de nous libérer du salariat ; elle a surtout privatisé notre attention, notre langage, nos affects. Le travail disparaît, mais pas la domination.
Penser ce que nous faisons : une ontologie de l’actualité
La force de la pensée arendtienne ne réside pas dans l'élaboration d'un système théorique classique, mais dans une méthode singulière : penser le présent à partir de ce que nous faisons. Non pas penser le travail comme concept, mais penser sa disparition comme signe d’époque.
Arendt, à la suite de Kant ou de Foucault, déploie ce qu'on pourrait appeler une "ontologie de l'actualité" : une analyse qui tente de dégager l'essence historique de notre présent. Et ce présent, selon elle, s'organise autour d'un drame à deux actes : dépouillés de notre identité politique, nous l'avons remplacée par l'identité laborieuse. Et maintenant que le travail s'efface à son tour, il ne reste rien.
Avec l’IA générative, l’automatisation devient universelle. Non seulement elle automatise le geste, mais elle simule le langage, la pensée, l’intuition. Ce que nous faisions pour nous sentir humains — écrire, interpréter, imaginer — semble désormais reproductible par des machines. Dès lors, penser ce que nous faisons revient à se demander si nous faisons encore quelque chose d’irréductiblement humain.
De l’animal politique à l’animal laborans
Dans La condition de l'homme moderne (1958), Arendt dresse une généalogie des activités humaines. Elle distingue le travail (travail biologique, reproduction de la vie), l’œuvre (création d'objets durables), et l'action (engagement politique, discours, construction du monde commun).
Les Grecs, dans ce schéma, accordaient la plus haute valeur à l'action, méprisant le travail comme nécessité vitale déléguée aux esclaves. Ce modèle antique devient, chez Arendt, un paradigme critique. Elle ne cherche pas à y retourner, mais à en faire un miroir de ce que nous avons perdu.
Dans la modernité, le triptyque grec s'est effondré. Le politique a été marginalisé, l’œuvre soumise à la production, et le travail érigé en valeur suprême. L’homme moderne devient animal laborans, défini par sa productivité et sa fonction dans le métabolisme économique. Ce règne du travail n’a plus rien à voir avec l’émancipation par le faire : c’est l’engloutissement du politique dans la survie.
Le paradoxe de l'automatisation : l’aboutissement et la ruine du projet moderne
L'automatisation, loin d'être une résolution, radicalise ce paradoxe. En supprimant le travail, elle ne libère pas l’homme pour une activité plus élevée, car ces activités ont déjà disparu. Elle creuse le vide.
Aujourd’hui, l’IA ne se contente pas de prolonger l’homme : elle le remplace. Des robots cuisinent, livrent, cultivent, opèrent. Des algorithmes composent de la musique, rédigent des contrats, créent des images, orientent des décisions politiques ou médicales. L’économie devient machinique, la société programmée. Et cette transformation s’opère dans l’indifférence générale, voire avec enthousiasme, tant que la productivité augmente.
Goldman Sachs estime en mars 2023 que 300 millions d’emplois à temps plein pourraient être automatisés. Une note qui a agi comme un électrochoc, à peine quatre mois après l’apparition publique de ChatGPT. À l’inverse, le Forum économique mondial parie sur la création de 97 millions de nouveaux emplois. Mais ces projections, contradictoires, révèlent surtout l’incertitude radicale de l’époque.
Ce que les Grecs considéraient comme la condition d’accès à la vie libre — ne pas avoir à travailler — devient aujourd’hui un facteur de marginalisation. Car la société contemporaine ne reconnaît pas de valeur hors de la productivité. Ne pas travailler, ce n’est pas être libre : c’est ne plus être rien.
Une société de travailleurs sans travail : diagnostic d’un vide politique
La fin du travail ne menace pas seulement nos revenus. Elle remet en cause notre capacité à nous penser comme sujets. Arendt décrit une humanité déracinée, incapable d'habiter le monde autrement qu'en consommateur ou en spectateur. Désormais, même le travail ne nous structure plus. Et là réside l'urgence : comment reconfigurer notre rapport au monde dans une société où le faire n'est plus nécessaire, et l'agir n'a plus de lieu ?
Ce vide s’accompagne d’un paradoxe. Là où l’automatisation devait nous libérer du labeur, elle intensifie parfois le travail restant. En supprimant les tâches simples et gratifiantes, elle n’épargne que les missions complexes, incertaines, exigeantes psychologiquement. Le risque d’un burn-out généralisé guette, dans une société où l’humain n’a plus de sas, plus de respiration, plus de justification symbolique.
L’IA pourrait être l’occasion de restaurer le politique : délestés des tâches nécessaires, les humains pourraient se consacrer à l’agir, à la parole, à la délibération. Mais rien, aujourd’hui, ne garantit cette réorientation. Le risque est inverse : que la pensée elle-même soit externalisée, que l’espace public disparaisse, et que la démocratie devienne décor.
Que faire ?
Arendt ne propose pas de solution politique prête à l'emploi. Elle diagnostique. Mais ce diagnostic oblige.
Faut-il restaurer une aristocratie de l'œuvre ou de l'esprit ? En appeler à une nouvelle élite politique ? Peut-être. Mais il est plus urgent encore de recréer des espaces d’action où la parole ne soit pas un outil, mais un lien. De repenser l’œuvre comme ce qui rend le monde durable, au-delà du produit. Et de désacraliser le travail pour redonner place à ce qui, en nous, dépasse le métabolisme vital.
Cela suppose aussi de poser une question centrale : qui possède les machines ? Car dans une économie automatisée, celui qui possède les IA, les serveurs et les données détient la puissance. Répondre à la fin du travail suppose donc une politique de la propriété, de la technologie et du bien commun. L’alternative se dessine : néo-féodalisme technologique ou économie coopérative de la machine ?
La fin du travail comme signe d’époque
Arendt ne parle pas de futur. Elle parle du présent, à condition de savoir le lire. La disparition du travail n'est pas une chance, ni une catastrophe. C’est un symptôme. Elle oblige à rouvrir une question ancienne : qu’est-ce qu’une vie humaine ? Et surtout, dans quel monde voulons-nous vivre ensemble ?
Réseaux Sociaux & Cie
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux suivants
RESTONS EN CONTACT
© 2024. All rights reserved.
